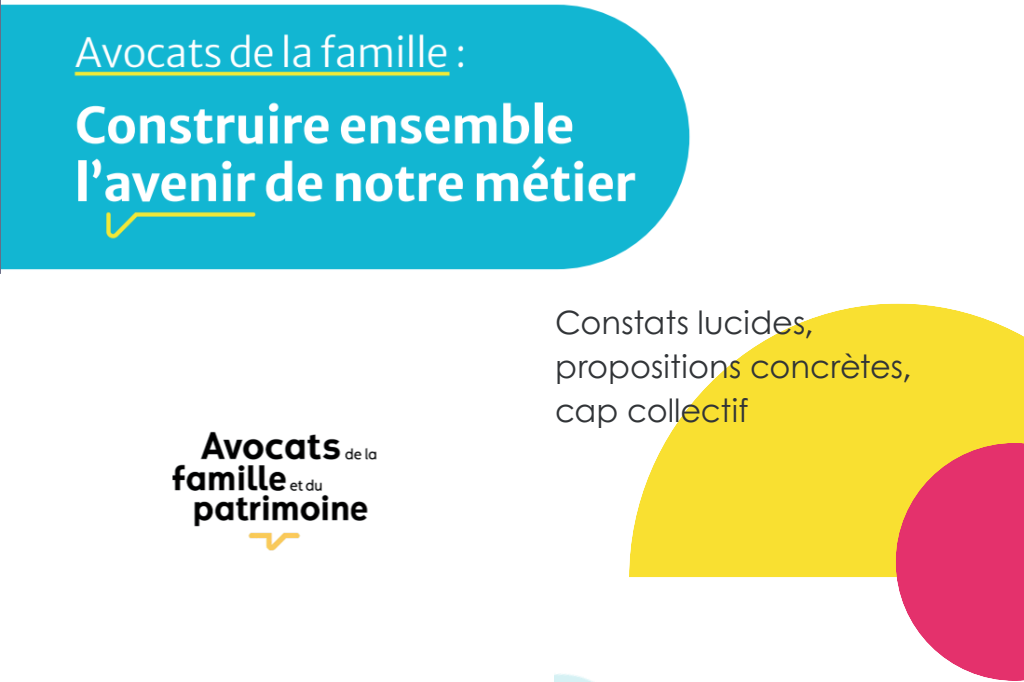(Cass, com, 27 novembre 2024, n° 23-12.151)
Un défunt laisse pour lui succéder son époux survivant et leurs deux enfants. Le conjoint opte pour la totalité des biens en usufruit. Divers comptes bancaires figurent à l’actif de la communauté, dont des comptes titres. À la suite du décès du conjoint survivant, les héritiers établissent la déclaration de succession de leur mère, insérant au passif une créance de restitution au titre des sommes existant sur les comptes bancaires au jour du décès du père et dont leur mère s’était attribuée l’usufruit.
L’administration fiscale remet en cause cette déduction au motif que les comptes titres figurant à l’actif de la succession n’avaient pas fait l’objet d’une convention de quasi-usufruit notariée ou enregistrée et émet un avis de recouvrement de droits complémentaires. La réclamation contentieuse des enfants est rejetée, ce qu’ils contestent en justice.
Les juges d’appel retiennent que l’usufruit légal portant sur les valeurs mobilières avait été inscrit sur la déclaration de succession. Cette inscription suffit dans leur analyse à considérer l’existence d’une créance de restitution.
La Cour de Cassation censure la cour d’appel au visa de l’article 768 du CGI qui prévoit que les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
La Cour de Cassation considère que la déclaration de succession ne suffit pas, à elle seule, à établir le caractère certain d’une dette de restitution, répétant la nécessité de la rédaction d’une convention de quasi-usufruit.